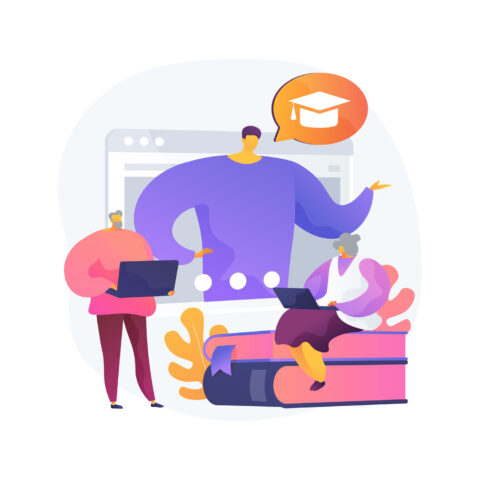Adoptées pour améliorer la qualité de l’air, les zones à faibles émissions (ZFE) devaient s’imposer dans toutes les grandes agglomérations françaises. Longtemps présentées comme un pilier de la transition écologique, elles sont aujourd’hui au centre d’un vaste débat. Suppression, assouplissement ou refonte : le dispositif divise les élus autant qu’il interroge les automobilistes. Où en est réellement la France ? Petit point de situation !

Un dispositif né pour améliorer la qualité de l’air
Créées pour réduire la pollution atmosphérique dans les grandes agglomérations, les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) sont inspirées d’expériences européennes comme celles de Londres ou Berlin. Inscrit dans la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) de 2019, puis renforcé par la Loi Climat & Résilience en 2021, le dispositif repose sur un principe simple : limiter la circulation des véhicules les plus polluants selon leur vignette Crit’Air, le tout avec une montée en puissance progressive qui commencerait par cibler les véhicules les plus anciens. Voitures particulières, utilitaires légers, poids lourd… chaque typologie de véhicules peut être soumise à des réglementations différentes selon les choix des collectivités.
L’objectif est de répondre à un enjeu sanitaire. Selon Santé publique France, la pollution atmosphérique reste responsable de près de 40 000 décès prématurés chaque année dans le pays. A l’échelle mondiale, l’OCDE estime que la pollution de l’air pourrait causer entre 6 et 9 millions de décès prématurés par an d’ici à 2060.
Une mise en œuvre progressive mais inégale
A l’origine, les ZFE devaient s’appliquer progressivement dans les 43 agglomérations françaises de plus de 150 000 habitants.
Selon les chiffres du gouvernement, 25 ZFE étaient actives dans l’Hexagone au 1er janvier 2025. Paris, Lyon, Grenoble, Strasbourg ou Rouen ont fait figure de pionnières. D’autres ont suivi, mais souvent avec prudence.
Les calendriers ont d’ailleurs divergé : certaines collectivités prévoyaient d’interdire les véhicules Crit’Air 4 dès 2024, d’autres ont repoussé l’échéance à 2026, invoquant des difficultés économiques et sociales.
2025 : le tournant politique
Les ZFE ont toujours été dénoncées par une partie de la classe politique. Même son de cloche de la part des automobilistes, nombreux à craindre de ne plus pouvoir utiliser leurs véhicules pour se rendre au travail.
Dès 2023, un rapport sénatorial alertait sur « une bombe sociale à retardement » pointant des « risques de fractures sociales et territoriales ». A l’automne 2024, c’est un collectif d’élus locaux, de droite comme de gauche, qui réclamait une suspension du dispositif.
Fin mai 2025, l’Assemblée nationale a adopté un amendement au projet de loi de simplification visant à supprimer les ZFE-mobilité dans leur forme actuelle. Le projet de loi intégrant la mesure a été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale le 17 juin dernier. Objectif : « laisser aux collectivités la liberté de définir leurs propres politiques de qualité de l’air » sans cadre contraignant national.
Ce premier vote, salué par certains comme « un retour au bon sens », a provoqué la colère de certains élus. Idem pour les associations environnementales qui rappellent que la France reste sous la menace de sanctions européennes pour non-respect des seuils de pollution de l’air.

Un avenir en suspens
Point important : l’adoption du projet de loi en première lecture n’acte pas la suppression des ZFE. Son examen doit désormais se poursuivre en commission mixte paritaire (CMP). Réunissant un groupe de quatorze députés et sénateurs, celle-ci sera chargée de rédiger une version commune du texte, et pourrait choisir de conserver, ou non, l’amendement lié à la suppression des ZFE. A date, les échanges n’ont pas débuté.
De plus, la suppression des ZFE pourrait également être censurée par le Conseil constitutionnel, qui pourrait estimer que la mesure constitue un « cavalier législatif », trop éloignée sur le fond de l’objet du projet de loi initial.
Il n’empêche que la situation reste particulièrement floue sur le plan politique. Certaines métropoles, comme Paris ou Lyon, maintiennent leurs restrictions, estimant qu’il serait absurde de revenir en arrière après plusieurs années d’efforts. D’autres ont suspendu leurs réflexions dans l’attente de nouvelles orientations nationales.
De son côté, le gouvernement cherche un nouvel équilibre. L’idée d’une “ZFE 2.0” fait son chemin : un dispositif recentré sur les villes les plus polluées, combiné à des aides renforcées pour les ménages modestes et les professionnels.
Quel avenir pour la qualité de l’air ?
L’abandon pur et simple des ZFE poserait plusieurs problèmes. Selon les estimations de l’Agence de la transition écologique (Ademe), près de 3 millions de véhicules très polluants pourraient être remis en circulation, entraînant une hausse sensible des émissions de dioxyde d’azote (NO₂) et de particules fines.
Sur le plan juridique, la France risque également de se retrouver en porte-à-faux avec la Commission européenne, qui a déjà engagé plusieurs procédures d’infraction pour dépassement des seuils de pollution. L’abandon des ZFE, pourtant déployées avec succès dans d’autres pays européens, interrogerait surtout la cohérence des politiques climatiques françaises, alors que le transport routier reste le premier émetteur de CO₂ du pays.
L’impact financier serait lui aussi important et pourrait priver la France de certaines subventions européennes conditionnées à la mise en œuvre d’une série d’actions pour améliorer la qualité de l’air, et notamment la création de zones à faibles émissions. Sur 2026, la France pourrait ainsi perdre plus de 6 milliards d’euros d’aides européennes. Elle pourrait aussi être contrainte de rembourser certaines aides déjà versées.
Un enjeu fort des municipales 2026
Si les ZFE divisent encore la classe politique, les enjeux liés à la qualité de l’air font toujours consensus. Tous les acteurs s’accordent sur la nécessité d’agir pour réduire les émissions, même si les moyens d’y parvenir diffèrent.
Dans ce contexte, les élections municipales de 2026 s’annoncent décisives. Car si le cadre national venait à s’assouplir, la responsabilité se déplacera vers les collectivités, qui devront proposer des solutions concrètes et adaptées à leur territoire. Chaque candidat devra ainsi composer avec une attente citoyenne forte : celle de respirer un air plus sain sans pour autant entraver la liberté de se déplacer.